27 novembre 2014
When the stars are right : Towards An Authentic R'lyehian Spirituality
08 septembre 2011
The shallows (Internet rend-il bête ?)
"Comment internet change notre façon de penser, de lire et de nous souvenir."
La traduction qui paraîtra en octobre s'intitule "Internet rend-il bête?" mais le titre original est plus subtil : "Les basses eaux" ou "En surface". La traduction allemande s'intitule "Qui suis-je quand je suis online ?"
Pour l'auteur, Internet est inévitablement le lieu futur des idées, mais il entraîne des problèmes d'attention et l'incapacité à s'immerger profondément dans des idées et des récits.
- La lecture silencieuse rapide a permis le développement d'une capacité originale de concentration et d'interprétation. Avant (lorsque la lecture était orale, lente) trouver la vérité restait encore une simple vérification de l'adéquation entre en propos et les symboles religieux et naturels déjà connus. Le fait de pouvoir passer moins de temps à décoder ou vocaliser le texte a permis de passer plus de temps immergé dans les idées et les descriptions, de suivre une argumentation ou une histoire en les analysant plus finement, d'être sensible à des variations de langage plus subtiles. Citant Eisenstein : "La virtuosité remarquable des nouveaux artistes littéraires pour contrefaire les sens à travers de simples mots exigeait une conscience plus aigue et une observation plus proche de l'expérience sensorielle, capacités transférées à leur tour au lecteur."
-Internet est un écosystème de technologies d'interruption : hyperliens, alertes, multimedia. Mais est aussi un média universel et bidirectionnel. Avec 8h /j devant écrans, une grande quantité de texte est lu, mais par petits bouts.
- La lecture sur internet : est fragmentée et fragmentante. Surfer le net : est une suite continuelle de micro-décisions, jugements, qui gènent la concentration et la mémorisation. On passe son temps dans de l'"extraneous problem-solving" : à résoudre des problèmes extérieurs au propos (comme si on lisait un livre tout en résolvant des mots-croisés à côté). Hypertexte/hypermédia/alertes : ces outils étaient destinés à résoudre le problème de l'overdose d'informations, mais l'on finalement exacerbé. Le contenu proposé en ligne n'est pas fait pour être maîtrisé (cela demanderait une mémoire immédiate trop élevée) mais pour être simplement parcouru. De plus ce qui est traversé est trop désordonné pour être assimilé par la mémoire à long terme.
La lecture est effectuée "en diagonale", ou plutôt en forme de F. On passe en moyenne 20 à 25 seconde par page, dans le but d'identifier quelques mots-clefs ou phrases saillantes.
Cela fait qu'Internet développe bien certaines formes d'intelligence : visuo-spatiale et tri de données multiples. Mais diminue la mémorisation, la concentration et l'analyse.
-Google : outil très efficace, au point de devenir notre outil mental unique, la façon dont nous nous représentons l'accès idéal au savoir. Google à intérêt à ce que l'information circule de la manière la plus fluide et gratuite possible (pour mettre le plus d'Adwords dessus). Conséquence : il découpe le savoir jusqu'à son unité minimale (Googlebooks est concrètement utilisé comme une bibliothèque de paragraphes, et non pas comme une bibliothèque de livres).
- Conséquences sur la vision de la littérature et des textes. Sur les médias internet "social concerns overrides litterary ones" (les préocuppations sociales dépassent les préocuppations littéraires). La lecture n'est qu'un moyen de conversation, où le contenu doit avoir un style facile et où l'on peut reconnaître immédiatement des images communes à tous. Citant un article de l'Annual Review of Sociology : "Era of mass book reading was a brief anomaly in our intellectual history". Et citant Clay Shirky "La littérature ne vaut pas le temps qu'elle prend à être lue" (comme si elle n'était qu'un moyen, ennuyeux, de parvenir à autre chose).
- La forme d'un média change notre vision du monde, de manière globale et durable. Les médias ne sont pas des outils neutres (bons ou mauvais selon usage). Ce sont des outils cognitifs, des technologies intellectulles, qui comme les cartes, les horloges, ou l'écriture, modifient notre rapport au monde. Ces changements sont durables et extensifs, en raison de la plasticité des neurotransmetteurs. Le cerveau peut très rapidement programmmer des habitudes, bonnes ou mauvaises. Le cerveau demande rapidement à être nourri de la manière dont le net le nourrit. Internet introduit de la discontinuité dans tous les autres médias et expériences.
- Fausse idée que notre cerveau "stockerait" des "informations", et que donc internet pourrait nous libérer de ce travail de mémorisation. La mémoire est active : elle consiste dans l'acte de constituer et reconstituer des souvenirs, dans des synthèses toujours différentes. Ne pas faire travailler la mémoire affaiblit la globalité de l'esprit. Pour rester en vie, la culture ne doit pas simplement être de l'information stockée, elle doit être renouvelée dans l'esprit des nouvelles générations. Notre intelligence s'aplatit en une Intelligence Artificielle : nerveuse, rapide, de mémoire à court terme, établissement de simple liens. Les logiciels peuvent certes nous libérer de tâches aliénantes... jusqu'au moment où ils font le travail même de l'esprit à notre place, et nous empêchent ainsi d'acquérir des compétences.
- "Nous évoluons à de cultivateurs de notre savoir personnel à chasseurs et cueilleurs dans la forêt électronique des données". Le net est une bibliothèque où l'on peut retrouver de l'information, et non pas une bibliothèque qui aiderait à se construire soi-même en constituant son savoir personnel. Il réduit notre capacité à pouvoir choisir ce à quoi on prête attention et comment on choisit de l'interpréter. "Notre problème aujourd'hui est que nous perdons notre capacité à équilibrer ces deux états d'esprit : la pensée méditative et la découverte rapide."
08 novembre 2010
13 minutes

Formule orginale de conférence à l'Université Paris Diderot : six intervention successives de 13 minutes chrono, sur des sujets divers. On sent la twitterisation du monde à l'oeuvre... tant mieux quand elle oblige les intervenants à rendre leur propos compréhensible et intéressant. Dialectique entre vitesse et contenu.
29 septembre 2010
Le complexe d'Arlequin

Le complexe d'Arlequin
Eloge de l'inconstance. Gilles Achache
Le zapping est l'opération intellectuelle qui consiste à faire se succéder sans transitions des dispositions d'esprit différentes. Le téléspectacteur adopte en quelques secondes les attitudes mentales qui vont lui permettre d'apprécier aussi bien TF1 ou Arte. Cette disposition va lui permet de maîtriser des narrations complexes, qui sollicitent son rôle actif (24h chrono,Memento, les films de Lynch ou même Plus belle la vie qui compte beaucoup plus d'intrigues parallèles que les séries du même type des années 60). Ainsi le spectateur devient apte à identifier sans cesse de nouvelles règles du jeux, comme dans les jeux vidéos. En Art : la pub et la pop culture lui montrent les règles de l'art contemporain (pas les musées ou les Maisons de la Culture). En Politique : le citoyen vote en tenant compte des équilibres politiques plus que des idéaux universels. Le problème n'est pas que la politique soit un spectacle, mais qu'il soit mal raconté et mette uniquement en avant les prises de décision, sans contexte ni conséquences.
Conséquences négatives :
Tout est mis en forme pour être "zappable", on peut prendre une émissions de tv à n'importe quel moment, et même dans la presse : pratique de l' "editing" (gros intertitres au milieu des articles de presse) pour pouvoir zapper dans lecture.
On pense pouvoir zapper la réalité comme on zappe une information déplaisante.
Faire avec le flux ou se vouloir extérieur à lui ?
Le zapping mental suppose à la fois adhésion et glissement, être bon et mauvais public, jouer le jeu entre croire et ne pas croire. En théorie on déteste la télé, le marché, le flux des informations. En pratique on les adore et on adore les critiquer. Ils n'exercent pas une influence malgré nous, de type violente ou inconsciente, mais plutôt ils donnent - plus ou moins bien - des formes communes et publiques aux représentations individuelles. Cette vision de G.Achache s'oppose ainsi à l'hypercritique de Bernard Stiegler pour qui la télé et le marché sont des addictions, du désir sans médiation, empêchant la sublimation, et qu'il faudrait amender par un contrôle démocratique.
13 septembre 2010
Absolument dé-bor-dée ! ou le paradoxe du fonctionnaire.

Le véritable sujet de ce livre de docu-fiction est : comment le vocabulaire du management peut s'enfler jusqu'à remplacer le contenu même du management, et devenir l'objet principal de travail.
L'ouvrage décrit un service Relations Internationales de Collectivité, qui peine à définir sa fonction, à évaluer son propre fonctionnement, à lancer des projets réalistes.
Le directeur s'agite et explique à ses collaborateurs : "Les process doivent être rationnalisés et il faut globaliser les inputs". Or ce qui est intéressant, c'est que prise en soi, l'idée est sans doute excellente, même si elle ne veut rien dire d'autre que "il serait bon de rassembler les informations pour mieux les organiser". Mais faute de se relier à des objectifs concrets et modestes, ce slogan reste incantation et mur de fumée.
Mais l'agitation autour de cet ouvrage concerne des sujets bien plus importants : Les fonctionnaires français sont-ils paresseux, Faut-il sanctionner un fonctionnaire qui écrit un roman contre les fonctionnaires, Zoé Shepard est-elle insupportable au boulot, les membres du service RI de la Région Aquitaine sont-ils sympas ?
18 août 2009
S'acheter une vie

Le consumérisme change notre relation à l'identité et au temps, beaucoup plus que notre simple relation aux produits eux-mêmes.
- L'individu ne définit plus sa place dans la société par ce qu'il produit mais par ce qu'il consomme.
- La société n'apparaît plus comme une cause à laquelle on sacrifie nécessairement une part de son plaisir, mais elle se manifeste sous la forme de festivals d'unité communautaire.
- Alors que le principe de réalité était autrefois géré par la société (morale, vérités, autorité, grandes causes) il est dérégulé et privatisé : l'individu doit fixer lui-même ses responsabilités et ses limites. Tâche écrasante dont il se libère auprès d'organismes commerciaux. Le principe de réalité se traduit paradoxalement par l'obligation de rechercher le plaisir.
-Le sentiment d'urgence fournit aux individus le soulagement illusoire de triompher de leur excès de possibilités, de leur inadaptation continuelle.
- Temps pointilliste, où chaque moment est séparé des autres, et apparaît illusoirement comme potentiellement plein.
Thomas Eriksen, La tyrannie de l'instant : « L'instant présent lui-même est menacé dans la mesure où l'instant suivant arrive si vite qu'il devient difficile de vivre au présent ». « Nous sommes sur le point de créer une société dans laquelle plus aucune pensée ou presque n'a plus de quelque centimètres de long. »
02 juin 2009
Quel modèle de bibliothèque ?

Alors que les bibliothèques anglo-saxonnes visent à rendre service à l'usager, les bibliothèques françaises ont l'ambition de le transformer.
Cette visée « aristo-démocratique » (et sans doute issue de la Révolution française) a pu soutenir le développement des bibliothèques françaises et leur attribuer un rôle symbolique fort. Néanmoins elle est remise en question quand les chiffres d'inscriptions atteignent leur limite.
La France a subi l'influence mixte de plusieurs modèles historiques contradictoires, mais en les cumulant : La Bibliothèque d'étude + La Bibliothèque populaire + La Public Library + La Maison de la Culture. Cela fait sa richesse, mais cette universalité des tâches alourdit son fonctionnement.
L'ambition d'amener tous les usagers à la Culture n'est pas vraiment un modèle uniforme. En effet, hormis quelques caractéristiques communes comme l'accès direct et la valorisation, cette mission peut justifier toute priorité : le militantisme/le consumérisme, les nouveautés/la collection, les grosses BMVR/les BM de quartier, internet/l'imprimé, la littérature/l’information pratique, le catalogage/les heures d'ouverture... Bref les débats des bibliothécaires ne peuvent pas vraiment y trancher ce qu'il faudrait faire ou pas, car in fine toute option peut être rattachable à une légitimation « pour le public ».
D'où peut-être la tentation actuelle de simplifier les choses en adoptant le modèle de la Public Library (la bibliothèque au service de l'information et de la formation des différents types de populations), mais au risque de perdre une certaine visée universelle de la culture, à laquelle d'ailleurs les usagers français eux-mêmes sont attachés.
Quel modèle de bibliothèque ? / Ouvrage collectif paru aux Presses de l' Enssib ; décembre 2008.
22 mai 2009
Espèce de faible lecteur
Microtrottoir : Quelle place tient la lecture dans votre quotidien ?




Effectivement pour beaucoup de personnes ayant une pratique morcelée de la lecture, celle-ci est assimilée aux "grands classiques" du collège (qui font mal à la tête) et à quelques romans et essais contemporains (un moment de détente, de sagesse). Migraine ou aspirine.
La fatigue et l'absence de temps invoqués traduisent aussi la difficulté de concentration et de repérage.
17 mai 2009
Espèce d'usager de médiathèque

Un point de vue iconoclaste sur les usagers des médiathèques par Philippe Muray.
L'usager de médiathèque serait la figure emblématique des nouvelles classes moyennes, qui ne diposent ni des solidarités des anciennes classses populaires, ni de l'indépendance intellectuelle des anciennes classes bourgeoises.
Sa manière de vivre en société ne se ferait plus que sous le mode de la fréquentation, la fête permanente, la revendication individuelle.
« Voilà Festivus festivus : l'être qui s'est déchargé de la totalité de son existence sur l'Etat en échange de la disparition de sa liberté, disparition qu'il ne voit même pas puisqu'on réussit à le passionner avec la baliverne de réappropriation de son existence et de son environnement. »
« En terme de sociologie de bazar médiatique, il s'agit grosso modo d'achever de néantiser les classes populaires et de les transformer en public de médiathèques, c'est-à-dire en classes fréquentantes : diplômés, couches moyennes et supérieures, cadres, étudiants ; c'est-à-dire la clientèle captive de la festivisation intégrale, et dépendante pour tout le reste, dépendante de l'Etat, stato-dépendante, dépendante jusqu'à ne plus savoir comment on épluche une pomme de terre, comme on cuit un oeuf ou fait un enfant sans en appeler aux travailleurs sociaux et aux aides familiales. »
A rapprocher peut-être du sentiment toujours un peu infantilisant qu'il y a se plier aux codes et aux choix d'une bibliothèque, qu'elle soit populaire, spécialisée ou tout public.
09 mai 2009
La société malade de la gestion

Beaucoup de cadres et d'élus sont fascinés par la gestion, qu'ils assimilent à la rigueur et à l'efficacité. Or elle n'en est que le versant quantifiable et abstrait. Ses paradigmes ayant été conçus pour s'appliquer aux choses, elle ne saurait s'appliquer sans dommages aux hommes où à la société dans son ensemble.
Le contexte : le développement des industries de services.
Le téléphone et l'ordinateur sont les outils de la majorité des exécutants aujourd'hui. Ces évolutions technologiques allègent la pénibilité physique mais accroissent la pression psychique. « Ce que l'homme gagne en autonomie, il le paie en implication. » Les critères de qualité du travail étaient évidents dans le monde de l'artisanat et de l'industrie (« un mur mal agencé, ça se voit ; un moteur, ça marche ou ça ne marche pas ») , mais ils deviennent abstraits dans le monde de l'administration et des services. D'où la fonction de mobilisation psychique des outils de la gestion : les tableaux de bord semblent rassurants face à la peur de l'incertitude et de l'arbitraire.
La part bénite et la part maudite de la gestion
La gestion managériale est un outil nécessaire, qui améliore remarquablement l'efficacité, la responsabilité individuelle et l'innovation. Mais si elle se substitue au sens (qui est de produire de la richesse pour le bien commun), elle engendre alors des effets pervers : individualisme, compétition à outrance, dictature du chiffre (perçu comme objectif), instrumentalisation de l'humain, injonctions paradoxales. Elle devient une idéologie de perfection et d'oubli du négatif (des conséquences sur la société, le psychisme, l'environnement). Elle se préocuppe uniquement de la rareté matérielle et dénie toute réalité aux idées, symboles, valeurs.
« La gestion managériale est un mélange de consignes rationnelles, de prescriptions précises, d'outils de mesure sophistiqués, de techniques d'évaluation objectives, mais aussi de consignes irrationnelles, de prescriptions irréalistes, de tableaux de bord inapplicables et de jugements arbitraires. »
Rationalisation et Raison
« Beaucoup de gestionnaires entretiennent une confusion entre rationalisation et raison. La rationalisation est un mécanisme d'échange, à partir de la recherche d'un langage commun et d'un souci de clarification. Mais c'est aussi un mécanisme de défense qui, sous les apparences d'un raisonnement logique, tend à neutraliser ce qui est gênant, ce qui dérange, ce qui n'entre pas dans « sa » logique. En ce sens, la rationalisation est du côté du pouvoir, alors que la raison est du côté de la connaissance. Cette dernière n'a pas à se soumettre à un principe d'efficacité mais à un principe de recherche du sens. Or, sur bien des points, l'efficience s'oppose au sens. La connaissance doit permettre à chaque individu de rendre intelligibles son expérience, les situations qu'il rencontre, les conflits qu'il est amené à vivre. »
19 avril 2009
Overdose d'info : guérir des névroses médiatiques
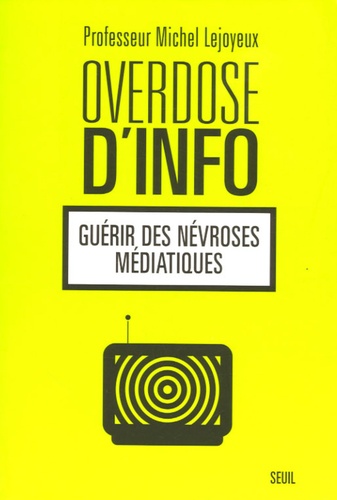
Notre intérêt pour les actualités instantanées ne provient pas d'une volonté de comprendre ou d'agir, mais d'un souci d'appartenance et de sécurité psychologique.
Selon Michel Lejoyeux, il s'agit d'une névrose "raisonnable", qui derrière l'apparence de sérieux et de maîtrise permet surtout de socialiser nos émotions et angoisses. Il décrit les tendances anxieuses, hypocondriaques, narcissiques ou compulsives que peut recouvrir cet intérêt.
Il conseille de se détacher de cette fascination pour l'actualité immédiate - en lisant par exemple le journal de la veille - pour retrouver finalement une relation plus active et engagée dans la réalité. « La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition... et que les images qu'on lui présente. »

Antony Perkins filmé par Welles dans Le Procès
Dans une relecture intéressante, l'auteur compare le consommateur d'information aux protagonistes des romans de Kafka. S'il est incapable d'atteindre le Sens, c'est parce qu'il le projette au-delà de lui-même et se fourvoit alors dans des méandres dont il est le créateur.
« Les personnages de Kafka font d'un simple procès une affaire d'Etat tant ils ont besoin d'en comprendre les détails. Un arpenteur victime d'un malentendu souffre autant de la méprise de l'administration que de son besoin de deviner les desseins secrets du Château. Il est piégé par sa soif de connaissance, son besoin d'aller au fonds des choses et de faire toute la lumière sur son affaire. »
12 avril 2009
Les nouveaux intellos précaires


Huit ans après la publication des Intellos précaires, ses auteurs observent une systématisation dans la précarisation des métiers consacrés à la création et à la transmission d'idées : écrivains, éditeurs, journalistes, scénaristes, chercheurs et enseignants.
Cela induit une crise de l'offre de contenus culturels, dans une véritable course vers le bas : actualités uniformisées, recherche orientée sur des résultats à court terme, division par 6 du nombre d'artistes produits, fusions et reventes des maisons d'édition.
Pour dépasser l'individualisme structurel – subi ou choisi – des intellos précaires, le collectif « Sauvons la recherche », la « Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse », ou encore les Syndicats et Association intégrant une section « Précaires » sont décrits comme des initiatives à imiter.
Il ne faut pas confondre le gratuit « facteur de démocratie et d'égalité » et le gratuit « stratégie de marchandisation, investissement sur vos dépenses à venir ».
« C'est celui qui conçoit le livre qui est le plus fragile de la chaîne. Le seul (enfin on l'espère) qui est rémunéré presque toujours en dessous du smic.»
(A noter p.241-253 : une approche assez équilibrée concernant la polémique du Droit de prêt en Bibliothèque. En 1998, on comptait 350 millions de livres vendus et 150 millions de livres prêtés. « Comme la bière appelle la bière, le livre appelle le livre. A certains égards, les bibliothèques jouent ce rôle de promotion par le gratuit que nous évoquions plus haut pour la lessive ou les chips. »)
15 mars 2009
La lecture : toujours recommencée

J'ai acheté un Cybook en novembre dernier.
C'est l'ebook qui a le moins de boutons.
Dessus j'y ai lu :
Nouvelles histoires extraordinaires / EA Poe
Le cauchemar l'Innsmouth / Lovecraft
La croisade des enfants / Schwob
En route / JK Huysmans
Souvenirs de la maison des morts / Dostoïevski
Bref je constate que je lis des trucs glauques sur mon Cybook.
01 février 2009
Economie de l'hypermatériel et psychopouvoir
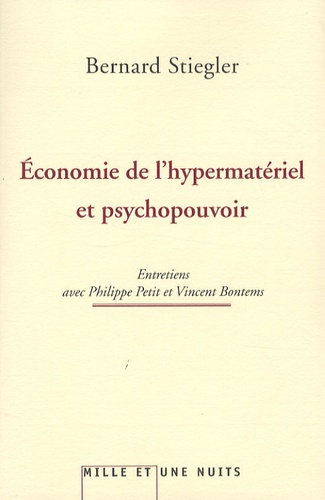 Economie de l'hypermatériel et psychopouvoir.
Economie de l'hypermatériel et psychopouvoir.Bernard Stiegler. Mille et une nuits, 2008.
Les changements technologiques modifient notre fonctionnement conscient et inconscient.
Nous vivons dans l'hypermatériel :
Les technologies ne sont pas immatérielles, au contraire l'information y est retranscrite dans des états de matière. Cela permet une reproduction matérielle du temps et de l'espace, sur un mode fictionnel, déréalisé, transitoire. A travers la technoscience, le réel ne nous apparaît plus que comme une simple figure des possibles.
Cette technologie est un psychopouvoir :
Notre confiance dans les "consistances" (les choses qui durent, les valeurs) est détruite. Cela induit démotivation, dépression (300 000 suicides par an en Chine) et favorise les pulsions au détriment de la sublimation. Dix heures par jour des écrans capte notre attention, limitant nos capacités de rétention (mémoire) et de protention (projet).
29 janvier 2009
La télécratie contre la démocratie
 La télécratie contre la démocratie
La télécratie contre la démocratieBernard Stiegler. Flammarion, 2006 (réédition 2008).
Ce sont les intermédiaires qui permettent la démocratie,
car l'individu s'y construit progressivement (identification aux parents, à la société, aux signes).
Or la télé-vision (les écrans médiatiques) court-circuite tous ces processus.
L'intensification des flux de symboles conduit à une désymbolisation massive, à un mode pulsionnel et immédiat du désir.
L'économie de marché a conduit à une société de marché, où le marché raccourcit les processus de désirs et de développement individuel.
La déresponsabilisation des individus ne vient pas de l'Etat, mais des industries de services
(réglant le désir sous forme de concepts marketing et ne développant pas de véritable savoir-faire chez ceux qui les exécutent).
La télévision conditionne de part en part la vie politique.
La télécratie électronique n'en est encore qu'à ses début :
* soit les pouvoirs privés y accentueront la désindividualisation
* soit une nouvelle puissance publique (de politique industrielle, médiatique et éducative)
permettra de nouveaux processus d'individualisation.
Seule une redéfinition de la fonction publique (sans fonctionnaires à vie) le permettra, en ne se limitant pas
à un simple rôle de redistribution des richesses, mais en se fixant des objectifs à long terme (ceux que le marché ne peut pas assurer).
Les facteurs technologie ne déterminent pas le social, mais justement ils l'indéterminent.
C'est pourquoi les télé-technologiques constituent des forces centrifuge, mais également des énergies centripètes :
elles sont les seules voies pour retrouver des circuits de transindividuation (individualisation+socialisation).
Le web 2 est un de ces pharmakons (poison et remède) : il est positif s'il contribue à reconstituer des circuits sociaux moins courts,
mais peut également accélérer les processus d'aliénation.
25 janvier 2009
La tyrannie technologique

Collectif. Editions l'Echappée, 2007.
La tyrannie technologique
Par la technologie, les individus se croient omniscients et tout-puissants, alors même que se développe leur impuissance politique et sociale.
Par des prothèses qui brouillent leur sens, ils perdent conscience de leur limitations, au lieu de pouvoir se concentrer sur le travail qui leur permettrait de s'en accommoder ou de les dépasser.
Il faut distinguer :
* la technique : un outil qui libère l'homme, avec lequel il transforme son milieu et lui-même.
* la technologie : quand cet outil devient son propre critère, mu par la pure recherche de profit et d'innovation.
Alors que le mythe du progrès moral linéaire et constant a été rejeté, ce n'est pas le cas pour le mythe du progrès technologique impératif.
L'emprise des écrans
La télévision : n'explique pas les événements mais les crée.
Dictature du temps sur l'espace, du maintenant sur l'ici, de l'image immédiate sur le texte explicatif.
Les faits sont présentés comme plus importants que les processus et les structures. Abolition des intermédiaires.
Le spectaculaire et l'exceptionnel sont faussement présentés comme des critères du significatif.
Etre "visible", être "mis en images" devient un critère de réalité.
Culte du visible : illusion de maîtriser un monde simplement en le voyant dans les moindres détails.
Conséquences : * infantilisation, pas de temps pour construire sa compréhension. * théorie du complot (du non-visible) * inaction
Les écrans : sont anesthésiques et addictifs. Ils vident l'esprit, sans le reposer.
La télévision permet à la conscience de se plaquer sur un flux, ce qui crée un sentiment de relaxation, qui disparaît immédiatement après et nous laisse de moins bonne forme et humeur.
26 mai 2008
Le monstre transparent : pourquoi n’en avoir rien à foutre de la Culture

Le monstre transparent : pourquoi n’en avoir rien à foutre de la Culture. Claire Cros.
(le + : énonce une évidence difficile à formuler ; le - : énonce une évidence difficile à formuler).
25 mai 2008
Génération participation

Le + : la contextualisation historique des besoins actuels d’expression
L’auteur utilise
* Avant 1945 - Besoins physiologiques - Qualité des produits
* Guerre Froide - Besoin d’appartenance - Marques, stars, symboles
* Mondialisation - Besoins de reconnaissance – Expérimentation, expression de valeurs personnelles
Le - : aucune délimitation du concept de « participation », d’où un optimisme exagéré
La « participation » recouvre dans l’ouvrage des concepts très différents : parfois réelle démarche horizontale et partage, parfois collaboration ponctuelle, parfois simple feedback ou possibilité d’expression. (Parmi les multiples exemples, l’auteur cite aussi bien les pays qui participent aux débats à l’ONU… et les téléspectateurs qui participent à Vidéogag en envoyant leur vidéos).
Si l’ouvrage détecte des dimensions participatives dans différents domaines (sciences, technologies, consommation, politique), leur réalité et leur efficacité n’y est pas évaluée.
[La « participation », quand elle est ponctuelle, superficielle, dirigée, pourrait très bien être une infantilisation marketing, comme semblent le suggérer les pions figurés sur la couverture du livre.]
15 mai 2008
Les dix plaies d'internet : les dangers d'un outil fabuleux

L'ouvrage de Dominique Maniez pousse plus loin l'analyse que celui d'Andrew Keen.
L'idée en est qu'Internet procure un sentiment de liberté immédiate, sentiment qui devra être contraint pour pouvoir se tranformer en pratiques de libertés réelles. La parabole de cette idée pourrait être la cryptographie, dont le développement a été nécessaire pour permettre paradoxalement plus de transparence dans le commerce électronique.
* Le sentiment de liberté procuré par internet est décrit à travers une citation de Dominique Wolton : "Autonomie, maîtrise et vitesse. Chacun peut agir, sans intermédiaire, quand il veut, sans filtre ni hiérarchie et, qui plus est, en temps réel.[...] Cela donne un sentiment de liberté absolue, voire de puissance, dont rend bien compte l'expression "surfer sur le net"."
* Dominique Maniez énumère les dangers cachés derrière ce sentiment de liberté : usage d'outils monopolistiques, non-respect des droits d'auteurs, trop-plein de publications et de commentaires inexploitables, communication réduite à son immédiateté et à sa forme, mythes cognitifs d'intelligence collective et d'éducation par les tics.
* Mais contrairement à Andrew Keen qui préconise le retour à d'anciens modèles, Dominique Maniez se prononce plutôt en faveur du déploiement de nouvelles solutions : développement de sites alternatifs concurrents, meilleure connaissance des mécanismes du réseau, facilitation des procédures de signature électronique. Pouvoir susciter, à côté de l'univers de l'anonymat, un univers où la signature authentifée permettrait d'autres développements.
Pour l'anecdote on trouve dans l'ouvrage des citations de Biblio-fr, O.Le Deuff, Figoblog et des cofondateurs de Biblioacid.
L'ouvrage m'évoque l'idée de l'articulation entre liberté formelle et liberté réelle, ou entre aliénation et médiation.
02 mai 2008
Le culte de l'amateur : comment internet détruit notre culture
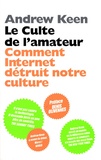
Le livre d'Andrew Keen est très simplificateur mais donne à penser. A prendre comme un retour de balancier contre les discours purement web 2.0. A mon sens voici les faiblesses et les points forts de l'argumentation :
- -
L'auteur ne problématise pas du tout le statut de l'expert (qu'il assimile 1/ à un professionnel, 2/ garantissant la véracité) ni le fonctionnement traditionnel des industries culturelles. On est donc tenté d'appliquer à son texte son propre propos : « Nous constatons aujourd'hui que la révolution web 2 favorise les observations superficielles au détriment des analyses en profondeur, les opinions irréfléchies au détriment des dialectiques éclairées ».
-
L'auteur prend uniquement des exemples à charge (piratage, vidéos idiotes sur youtube, spams, plagiats, falsifications) et les met tous sur le même plan. C'est partisan et caricatural. Néanmoins force est de constater que ces utilisations superficielles ou négatives forment une part très importante des contenus web 2.0, alors que les défendeurs de celui-ci en sont souvent réduits à évoquer ses « potentialités » positives sans évaluer ses réalisations concrètes.
+
L'auteur montre que c'est insuffisant de penser qu'internet donne le pouvoir aux individus face aux médias traditionnels. Pour lui, internet oppose surtout les industries culturelles traditionnelles (qui prenaient en charge des coûts et des processus parfois long de sélection et de création) aux nouvelles industries publicitaires, qui vont chercher à capter tous les revenus. La pub va devenir plus insidieuse qu'auparavant, puisqu'elle va de plus en plus chercher à se mélanger aux contenus eux-mêmes.
++
Pour Andrew Keen, le web 2 est cannibale : si dans un premier temps il semble augmenter la diversité d'accès à des oeuvres, à moyen terme il en détruit la source. D'une part par le piratage (musique, films) voire par la simple réexploitation concurrente (Wikipedia qui prend ses sources dans des ouvrages papiers). D'autre part par l'émergence de grosses sociétés (Google en premier lieu) qui monopolisent les publicités et les sites de recommandation. L'auteur imagine un futur ou plus rien ne pourrait se développer entre les films amateurs gratuits et les blockbusters.
Bref :
cet ouvrage semble incapable d'envisager de nouvelles formes de création via internet et ne voit de solutions que limitantes (interdictions, blocages)
il n'en reste pas moins qu'il pointe bien deux simplifications :
l'idéologie qui veut voir dans toute possibilité technique (télécharger, commenter, publier) une avancée culturelle, sans voir ce qu'elle fait perdre
l'idéologie qui veut nier la dimension économique de la création, sous prétexte que les industries culturelles en tiraient des bénéfices trop élevés

